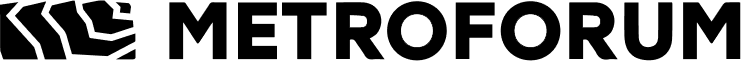L’étude Santé Environnement publiée en décembre 2024 apporte un éclairage significatif sur les impacts des politiques publiques urbaines dans trois domaines, visant à améliorer la qualité de l’air, à diminuer le bruit et à favoriser les déplacements actifs. Cette étude est très importante, car elle intervient à un moment où les mesures incitant à changer les comportements de mobilité pourraient marquer le pas (suspension du plan vélo), où l’amélioration lente, mais constante de la qualité de l’air dans les métropoles se confirme, et où la question de la végétalisation ou renaturation des villes devient un vaste défi technique et politique.
Des méthodologies confrontées à la complexité du sujet
Précisons qu’il s’agit d’une étude technique axée sur les déterminants de santé et fondée sur une méthode élaborée par l’OMS : les Évaluations quantitatives des impacts sur la santé (EQUIS). Cette méthode compare une photographie de situations existantes dans trois métropoles (Rouen, Montpellier et Lille) à des scénarios d’évolution de chaque déterminant. Cette méthode a d’abord été testée de manière robuste dans le domaine de la qualité de l’air, puis étendue aux domaines de la mobilité active, de la chaleur, des espaces verts et du son, considéré comme un autre déterminant environnemental auquel des populations identifiées sont exposées. L’objectif de l’étude était de confirmer les impacts sur la santé et l’intérêt d’agir sur les déterminants identifiés. La classification spatiale appliquée à l’ensemble des déterminants reprend les approches rudimentaires de l’INSEE en niveaux de densité de population (4 classes), opposant « urbain » (les trois premiers niveaux de densité) et « rural » (les deux derniers).
Par ailleurs, l’étude s’est efforcée d’incorporer une prise en compte des inégalités sociales et environnementales, et finalement principalement ajusté les classes de populations au regard d’un indice de défaveur sociale (European & French deprivation index) croisant taux de chômage, taux d’ouvrier, taux de bachelier dans la population non-scolarisée, ainsi que le revenu médian.
L’étude a ensuite élaboré des données d’exposition aux déterminants qui – notons-le – sont de nature très différente : espaces verts et températures sont territorialisés, et par extrapolation pour les autres. Enfin, l’étude tient compte « en théorie » des interdépendances entre les déterminants, mais il est de fait impossible d’examiner cette interdépendance, notamment en raison de l’insuffisance de données localisées.
Un focus sur deux déterminants : les pratiques de mobilité et la part de nature
Dans l’analyse des cinq déterminants, nous proposons de laisser de côté la chaleur (bien documentée, même si l’étude souligne l’insuffisance des connaissances sur la variabilité temporelle et historique des ICU) et le bruit (mesuré par le taux de cardiopathies ischémiques), pour privilégier deux déterminants liés à la mobilité et à la végétation.
Pour les espaces vert, appuyé sur la BD Topo de l’IGN, reprenant la définition très large de l’OMS : toutes sortes de végétations (incluant des zones bleues) et mesurée par un indice de télédétection.
Étude encore fragile : il n’y a pas de lien direct vérifiée par des données de la présence d’espace vert sur la santé mentale. En revanche, l’étude a pu mobiliser les données d’occupation des sols « OSO » produite par le Centre d’expertise scientifique (CES OSO) qui sont assez fines (avec des classes de végétation précises, permettant par exemple de distinguer si la végétation est composée de pelouse, de boisements de feuillus ou conifères, etc.).
Sur la base des données de mortalité, l’étude applique un coefficient et établit une estimation du nombre de décès évitables, suivant des recommandations (vivre à moins de 300 mètres d’un espace vert urbain de plus de 0,5 hectare pour l’OMS, par exemple). Cet objectif a-t-il été atteint sur le géotype visé ? L’a-t-on atteint moins qu’ailleurs sur la zone étudiée ? L’a-t-on atteint grâce à au moins 30 % de surface végétalisée ?, etc. Cette entrée offre déjà des résultats très intéressants. Notons notamment des données assez frappantes sur la MEL (p. 31) : c’est dans cette métropole que les populations les plus défavorisées sont les moins proches d’espaces verts de plus de 0,5 hectare à moins de 300 mètres. L’intérêt de l’étude est d’avoir incorporé des études de cas, notamment à Lille, concernant des projets envisagés : le terrain rue de la Haute Loge, le parc des Sarts/square Devos/jardin des Acacias. Elle soulève également le risque démontré par la littérature d’une forme de « gentrification verte » par l’implantation de la nature, mais reconnaît ses principales limites concernant le détail de la végétation (p. 39). On sait notamment quels effets les logiques du marché public ont pu avoir sur les essences plantées, par exemple.
Le travail sur la mobilité est tout aussi passionnant. Il repose sur un indice de mesure de la dépense connu, l’indice d’équivalent métabolique (MET), qui exprime l’intensité d’une activité en fonction du temps passé à l’exercer. Cet indice est exprimé en MET par heure et par semaine. La durée et la fréquence de l’activité sont appréciées à l’aide des EMD (exposome modale quotidien), avec lesquelles le MET-h a été croisé (nombre de trajets journaliers, part modale et durée moyenne d’usage du mode de transport), puis opéré par scénarios.
Le résultat le plus intéressant porte sur le plan vélo qui permettrait d’atteindre 12% de part modalité, qui est assez spectaculaire en termes de décès évités par ans. Reste des incertitudes multiples et des biais, comme sur la différenciation entre vélo et vélo électrique, le parti pris de ne pas quantifier les effets pour les + de 75%, et les déplacements le weekend (p. 53). Par ailleurs, aucune donnée fiable ne permet d’aborder la question de savoir si le fait de faire du vélo dans un environnement souvent pollué compense les bénéfices.
Également connaissance encore très insuffisante malgré les EMD du détail de l’axe sur lequel se situe le plus la marge de progression à savoir le détail des trajets de moins de 1km.
Conclusion, perspectives
Les conclusions ouvrent un immense chantier. Parmi celles-ci on peut souligner :
– des données locales qui existent (notamment sur la pollution) ou pas encore mesurables à l’échelle des IRIS
– des EMD qui mériteraient d’être en libre accès.
Par ailleurs des analyses complexes à mettre en œuvre, et l’impossibilité de croiser plusieurs déterminants, ainsi qu’un appel à plus d’interdisciplinarité !